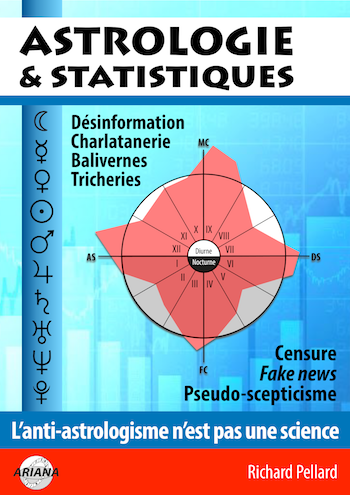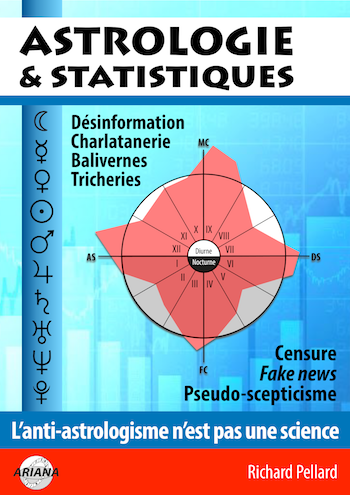Ce qui naît, ce qui meurt, le va-et-vient de la vie et de la mort, ne se passent pas en moi, mais hors de moi. Leur poussée m’est fraternelle, liée à ma volonté d’être. Je pourrais être craquant de richesses spirituelles et demeurer étranger à la vie. Car si je me rends libre au dedans, quelle est ma pesée sur le monde ? Je ne puis lui être ni un bien, ni un mal. Je lui importe peu.
Mais c’est dans la mesure ou j’ai foi en lui par mon action, que je puis lui être efficace. Si le monde authentique est mon amour, si ma camaraderie avec lui est vraiment sans barrières, tant avec ses monstres qu’avec ses anges, avec ses ténèbres qu’avec ses Soleils, si j’ai l’audace de le prendre à bras-le-corps contre moi, alors mes bras rencontreront les bras qui le soutiendront. Parce que je marche en authenticité au rendez-vous qu’il m’assigne, je rejoins en chemin la face étincelante de la vie.
***
Si j’ai toujours regardé du côté de l’homme, j’ai regardé aussi de l’autre côté, plus loin que l’homme, à ma droite comme à ma gauche, devant mes yeux comme derrière ma tête. Le monde s’insinue par mes doigts, par ma peau, par mon sang, et me repose comme une eau de rivière qui à peine se meut. Je sais que cela est mon don parce que je suis le franc-vouloir dans tout mon être.
Je sens le rond de la Terre se substituer à ce que je suis, et il me vient de l’orgueil et de la douceur de savoir que j’ai un corps qui sache si bien recueillir son poids et ses virulences, et d’être à la fois un rejet de ronce, la tache de mousse sur une rocaille, les ressauts du torrent, la fleur du pissenlit, tout ce sourire du monde éclos dans mon sourire, cette richesse de vivre qui prend mille sens, mais d’abord celui de vivre, simplement, parce que je vis, parce que je veux vivre. Et les voix cachées me deviennent claires parce que j’ai su me pencher, assez bas, sur la Terre.
Sur la grande balance de la vie, je vais et je viens, proche de l’harmonie dorée des choses qui s’équilibrent entre l’un et le multiple, le tu et le nous, l’en haut et l’en bas, les vivants et les morts. Mais je me délivre à chaque instant de ces plongées dans l’identification sacrée avec le cosmos : le voyant devient aveugle, et l’aveugle, à nouveau, redécouvre le monde…
***
Je me disperse dans la bienheureuse gelée des nativités, et j’émerge, ruisselant de ses vérités entr’aperçues. Je ne suis pas un anneau, mais la chaîne entière des vertèbres de la Terre, élargi à ses dimensions. Je fais partie de la fatalité des choses, de ce qui se construit et de ce qui se détruit, que je le veuille ou non, que j’en demeure ignorant ou non. Je ne suis pas l’hôte sombre et morne de mon moi, mais celui qui donne hospitalité à l’espace vivant, je suis entré dans les jeux de la surabondance vitale comme le sperme se fraye une voie vers la chaleur de l’ovaire pour les noces procréatrices, comme le feu dévore l’âme du métal. Pas d’existence privée, quand je suis voué à l’accomplissement de mes taches cosmiques, aboli dans la destinée des autres. Je suis cette énergie logée dans les atomes, et libérée, non ce néant carbonisé, résidu mort dont s’enorgueillissent ceux qui ignorent le vouloir-vivre créateur, l’explosion énorme des forces assujetties à une volonté gouvernante et dominée.
***
Si j’apparais dans les bourgeons d’un mélèze, sait-on que mon éclatement en leur sève poissante, un matin de mai, est semblable à la violence d’une cataracte qui s’écroule dans ses formidables poussées d’eau ?
Je ne suis pas recroquevillé sur mon unité comme une coque de fruit sec, sur son amande : des milliards d’unités se déchaînent dans mes cellules, m’absorbent et me rejettent tour à tour sur la superficie de la Terre, pour que je m’évanouisse dans la vision d’une réalité sans contours.
Et je passe inlassablement dans des formes diverses, végétales, animales, minérales, emmêlé dans le plancton de la volonté universelle, morcelé en pièces, dispersé en métamorphoses d’air et d’eau, de feu et de terre. Semblable aux dieux des mythes de la passion enfantés en d’autres et ressuscités dans l’unité restaurée de la vie…
***
C’est là, au milieu du déroulement des formes et de leur puissance, que je surprends ma conscience la plus profonde. Je me donne, je suis en donation constante, et si je retranchais une minute de cet état pour le consacrer à moi-même, il me semble que je cesserais d’être.
La solitude est la vie de l’instant, et l’instant, dans son fulgurant passage, me restitue cette part d’évidence et de pureté qu’il me dissimule en apparence, mais que je découvre et inventorie, en gracieuseté d’innocence. Car l’innocence possède une emprise absolue sur la vie. C’est elle qui la gouverne dans sa sauvagerie immaculée.
Les forces de la vie se dénoncent à moi, parce que je gis au milieu d’elles comme au creux d’une transparence d’eau, et qu’elles me parlent jusqu’à m’avouer ce que je pense en pensées à peine formulées. La pensée faite chair, la chair qui pense en échanges sensoriels.
Il me suffit de poser mon regard sur l’univers que me submerge en émerveillements pour que nous nous accordions mutuellement notre éternité.
Cette éternité est d’ici, elle est la bienheureuse conscience terrestre. Ainsi, j’élargis ma tessiture au-delà de toutes limites et demeure dans la fidélité de la féerie, dans son brasier où se broie le sens cosmique de la vie. Je besogne à l’essentiel de cette personne universelle, elle aussi besogne pour moi.
Féerie de la terre, être organique qui appelle l’homme dans ses fécondités, qui n’a de sens que si l’homme est lié à ses pulsations ! Prodigieuse est ma vie quotidienne, car j’ai forcé la Terre à entrer dans mon alliance et je dispose de ses limites comme j’ai échappé aux fables de mon moi et me suis accompli dans le tréfonds de cette montagne enchantée qu’est le monde des forces torrentielles.
Mû par cette tension, l’indomptable instinct qui me porte au dehors est une matière explosive, une charge, un excès de force — ce vouloir-vivre qui me fait multiple, et qui est grouillant d’univers et de foules…
Le témoignage des autres
La joie demeure toujours au dehors. Jamais je ne subis l’épreuve de moi-même, mais celle des autres, celle de l’azur ou de ces sèches pentes à schistes, ou de la respiration du monde qui m’arrive droit au travers de mes instincts.
Le témoignage que j’apporte est celui des autres.
En parlant, je ne me dis pas, je parle des autres, et ma voix, si je la fais entendre, est leur voix, non la mienne.
Je demeure toujours ignorant de ce que je suis, mais l’univers, lui, fend pour moi son écorce, et se délivre, majestueusement. À tout moment, je me tiens en son centre.
Si je cours après moi, je ne poursuis qu’un jeu de spectres, mais la prise de la vie, elle, est dans mon corps une réelle étreinte.
La Terre n’est miraculeuse que parce qu’elle ignore qu’elle est porteuse de miracles ! La féerie de vivre chaque jour en simplicité est le lien qui m’attache aux êtres, et eux sont attachés à cette féerie comme les fruits le sont à l’arbre. Le serpent darde sa tête dans la direction de celui qui le charme, mais le charmeur, à son tour, est pris dans l’enchantement de la bête déroulée qui le fixe : nous sommes tournés les uns vers les autres, vers cette même féerie.
Je dois tant de moi-même aux sentiers alpins, aux forêts de mélèzes, aux champs de lavande, aux odeurs de thym, aux cris des merles, aux hululements des chouettes, au vol des rapaces et des choucas, je suis tant rattaché, apparenté à la Terre, que rien n’est de moi en moi, bien que j’aie certitude que je puis atteindre seul les vérités et les lois de la Terre ! Toujours libre et sinuant au milieu d’elles, je suis les foules des plantes, des bêtes ou des hommes, en eux reliés, hors de la solitude. Et si je m’affirme devant tous un vivant, c’est que ma chair entière me l’affirme et me le révèle, bien plus par mes sens que par ma raison.
Ainsi, mon histoire d’homme n’est pas seulement la mienne, elle est celle des autres.
Ma patrie, ce sont les autres hommes, non pas une vague patrie, mais réelle, quotidienne, celle de la joie, de la souffrance.
Mon être prend l’ampleur de l’image mouvante de l’univers. Je ne suis pas un individu privé, je suis cette cellule cosmique illimitée à l’intérieur de laquelle s’accomplissent les alliances et la mort des créatures et des choses.
Quand je dis “je”, ce n’est pas de moi que je parle, mais de “nous”. Mon “je” est un “nous”.
***
Je me sens toujours en exiI, un déserteur, quand je ne fais que saisir ma propre face, quand je suis ma seule musique. Mon axe passe par le cœur de l’univers, et l’univers repose sur moi, O cosmologie féerique !
Quand bien même je serais dans le cube noir d’une geôle et que la vie ferait silence, j’entendrais la voix des hommes autour de ma réclusion, ma prison s’entrouvrirait à chaque instant comme une coquille d’œuf pour que l’oiseau de ma vie rejoigne les oiseaux du ciel !
Si profondément je suis enfoncé dans le monde que vers mon lieu de vie sur cette colline culminent les douleurs et les allégresses. L’aise des autres trouve son empreinte dans mon cœur, elle se fait aise pour moi, et leurs souffrances y laissent aussi leur passage.
***
Par cette solitude, je suis devenu familier avec le moindre remuement dans les anfractuosités des roches, dans la fibre des racines et les veines des schistes. Je regarde n’importe quel être au centre de sa lumière, dans sa félicité comme dans son angoisse. Il n’est pas une bribe de vie qui ne se hausse pour entrer chez moi, dans le silence des futaies de chênes. Les choses sont en attente de moi, comme moi d’elles. De toute éternité. Et de mon être, j’ouvre grande la porte à chaque instant, pour que nul n’ait à attendre. C’est là mon acte d’amour.
Cet immense dédain que j’ai de ma propre vie, et ce respect religieux de la vie des autres ! Jamais mes propres confidences ne me mettent en appétence, mais parler des autres et aux autres me donne allégresse et chaleur. Cette découverte toujours plus fervente que j’appartiens à une communauté, cet élargissement de mon être, pris entièrement dans la trame d’une même conscience, dans une identique aventure, où il n’est d’autre salut que de vivre ensemble en compagnonnage ou de déchoir !
Pureté brutale des masses minérales
Les masses de pierres qui s’étagent devant moi, rien ne contrarie en elles la puissance stable et la beauté ! Leur impassible marque et leur perfection, leurs réussites, sont de l’ordre des choses qui vivent. Rien n’altère, il semble, leur grâce silencieuse. Elles émeuvent parce que leur conscience n’est pas visible et qu’elles ne m’offrent pas de raisons de me reconnaître en elles, de les plaindre ou de me plaindre en elles. Surtout, elles ne troublent pas ma pensée, étant en simplicité avec moi, dans cette inertie apparente qu’est leur solidité, dans ce détachement lointain qu’est leur adhésion. Il n’y a pas de distance entre leur pureté brutale, leur innocence barbare et moi qui suis comme elles libre d’inquiétude et porte en moi le sentiment concret que jamais je ne trouverai de fin un jour. Leur lenteur et leurs tâtonnements dans la vie qui s’écoule sous leur écorce, sont l’aisance et la sûreté que je pressens dans mes propres membres, dans la loi communautaire qui me régit.
Rien d’individuel dans le grain de ces rocs et dans toute cette immuabilité qui s’édifie au fond des stratifications, comme dans moi-même. Ces pierres ont le temps pour elles, ce temps que j’accorde à l’humaine aventure sans cesse enroulée en elle-même et dépliée à la surface du monde et dont je suis. Cet empire de majesté concentrée venu à son plein, après des millénaires d’effritement et de reconstruction et qui continue dans la durée de vibrer au fond de ses structures minérales, c’est la sûreté et la patience de toute féerie aboutie à sa splendeur, à son point d’éclatement, dans une soumission unanime.
***
Tranquille composition de ces géométries fastueuses dont la souche rejoint les racines du monde ! Toutes ces puissances élémentaires ne sont pas figées dans une attitude définitive, leurs sursauts ne sont pas enchaînés. Une discipline s’y meut. Elle équilibre et commande le noble style de ces entassements et apaise leur violence. Il ne subsiste d’eux qu’une force triomphante qui proclame dans cette immobilité une science de la disposition, la science même de la Terre. L’ordonnance des lignes, la stabilité des volumes, la fusion des ensembles sont gouvernées. L’ordre souverain n’a pas été obtenu d’emblée et comme se jouant. Ces merveilles ne sont pas aveugles. De cette matière a été tiré un ordre dont je devine partout les traces, celles d’un déchaînement enchaîné, celles d’une colère domptée mais qui sont toujours là, à l’intérieur.
***
Chaque jour, j’apprends à découvrir à travers les figures de la pierre dispersée en blocs, les courbes qui définissent ses masses, la longue ligne flexible vigoureusement lancée qui entraîne toute sa matière dans l’espace et retombe avec elle par l’effet de la densité, ou bien, suspendue, brisée, afin que mon esprit en continue l’élan par l’imagination…
II y a rythmes autour de la montagne et structures. À sa puissance extérieure, au déploiement de ses attitudes correspondent un mouvement en profondeur, une force repliée au sein des éléments et qui tendent à la soulever, à envahir l’espace. La montagne est là, nerveuse, épaisse et drue, débordée de substance, avide de possession. Elle s’impose par son poids, ses pleins, ses proportions, son modèle, ses formes ramassées et comme aspirées par l’antique limon ou heureusement dressées dans l’espace pour le conquérir. L’orientation de ces masses, les mouvements qui les portent à se souder aux autres chaînes, les contrastes des ondulations rompues, les saillies heurtées qui tout-à-coup s’élèvent et se profilent sont en rapport étroit avec l’esprit organique du roc, sont en conséquence de l’effort intérieur qui dégrade, détruit, ronge et leur donne une physionomie particulière par l’intime travail du terrain dans ses couches profondes.
Je lis par le dedans ce qui ressort en images sur la surface des pentes. Et chaque pente porte, marquée dans ses gazons, dans ses sources et ses forêts, ses états antérieurs, son hérédité minérale, ses formes modelées par les ancêtres, toutes les traces de son passé, depuis son enfance. Les ridements accentués de son sol, les failles comme à l’emporte-pièce qui les balafrent, la carrure des croupes traduisent les événements souterrains qui ont bouleversé ses entrailles. Ce visage précis et dur me dit par ses sites pourquoi ces vallées sont là et, plus loin, le torrent et plus haut, les pâturages et encore plus haut, les gigantesques cimes. Il est l’aboutissement des millénaires.
***
C’est là le corps terrestre de l’univers que je palpe en plein et qui me ramène à ma genèse. Ces complexes édifices en épaisseurs gondolées, ces empilements de nappes et de formes livrées a la morsure de la neige et des eaux, sont des accumulateurs de vie, dans leur chaleur, leur humidité et leurs boues fécondes qui couvent et créent. Monstre hermaphrodite, bête bissexuelle dont je suis le descendant, à travers la succession des ancêtres, dont je suis sorti d’un peu de vapeur, de pression, de substances terreuse, organique et organisée. Je ne puis me détacher de ces molécules mises en mouvement, qui sont concentrées dans le limon de ces vallées comme la perle l’est dans l’huître vivante. Tout dans ces roches me parle de moi, de ma série d’êtres dans la vie minérale faite de poussière chimique, d’atomes, de grenailles animées, d’existences latentes qui paraissent mortes mais que la chaleur et l’eau transmuteront. Je suis bien de ces matières dont la Terre est la faiseuse, une de ces stalactites ou stalagmites que l’énergie solaire a réveillées un jour, il y a des millions d’années, mises en éclosion et jetées dans le tourbillon d’une vie intense…
Cette montagne n’est qu’un laboratoire géant, pressée par l’océan de l’espace cosmique et dont l’écorce chaude a lâché la multitude des créatures luxuriantes. C’est pourquoi je suis de soufre et de phosphore, de sel et de fer, substance identique à celle que je foule avec respect, car il me semble que je marche sur moi-même… Je ne suis que celà : un peu de roche sédimentaire transfigurée, un peu de limon parvenu à un certain stade de haute transformation, comme l’eau devient de la neige ou de la grêle. Ma vie est cette matière grasse, gazeuse, chimique, en mouvement d’équilibre, comme la chaleur, la pluie ou la vibration des sons. La Terre est la vie et la vie est la Terre. Mes yeux sont les milliards d’yeux de l’univers. L’animation de mon corps est l’activité radiante de la diversité des éléments. La montagne est la brasseuse d’êtres vivants, comme la mer et l’espace.
II y a de la substance stérile et il y a de la substance féconde : l’une est la mort, l’autre est la vie. Mais l’une et l’autre sortent de l’une et de l’autre, à l’infini. Le commencement de la vie débute par la vie, la fin de la vie n’est que le commencement de la vie. La Terre, c’est le premier homme et la première femme de toutes les créatures et de toute chose. Elle représente les entrailles sacrées. Chaque être qui naît est un peu de cendres qui se sont mises à s’animer. Nous foulons la source de notre propre existence. Chaque nouveau-né est une réussite dans l’anneau de l’éternité de la vie, du retour sans fin. Les morts ne sont que des futurs vivants. je nais, je meurs. Je nais de la Terre, je meurs dans la Terre. Ma naissance n’est qu’une pincée de boue dans laquelle je disparais. Cette mort est la résurrection des hommes sur la Terre. Tout ce que je représente se retrouve dans les innombrables formes que la nature revêt et qui se disperseront dans l’univers et l’univers poursuit son existence en me résorbant et en me rejetant de ma poussière, nouvel Adam !
Car je ne périrai jamais. La mort ne supprime pas mon corps, elle ne fait que le transfigurer. Le néant n’existe pas. Il est impossible. Aucun atome de mon être ne peut s’évader de l’infini. Je continue à vivre en mourant et de cette mort je revivrai comme un “resurgi” de la nature bouleversante !
Mes yeus emportent ma pensée
Mes yeux jetés dans ces mélèzes ou dans ce vent du sud, je sais qu’ils gardent du simple toucher de leur rétine, les moindres attitudes de ces arbres-fées, les moindres entrelacs de cet air remué. Mes yeux m’échappent sans cesse. Ils courent derrière tout ce qui les frappe, emportant ma pensée dans leur profondeur qui attend, heureuse d’être baignée dans cette lumière couleur d’huile et de noisette qui est prise en eux définitivement, et dans cette douceur du blanc qui la cerne.
La crudité des couleurs, le gonflement des formes, le vide de l’éther, sautent dans mes yeux et en moi, qui suis tout yeux. Et je sens par à travers moi les contrecoups de ces décharges au creux de mes paumes, à la plante de mes pieds, dans l’anse de mes bras et l’arbre de mes bronches. L’écorce miroite, la face du vent miroite, et des images se chevauchent au fond de mon corps, pressées et tremblantes, elles me touchent jusqu’à l’intérieur des os.
Je balaye de mes regards les surfaces aimées de la Terre dont je dénombre les secrets, avec la pointe de leurs iris qui les cisaillent, avec les palpes de leurs rayons qui les débusquent. Mes yeux sont à l’œuvre au loin. Leurs visions demeurent elles-mêmes. Les êtres et les choses où je promène leur royauté demeurent tels qu’ils sont dans leur éclat. Je ne les façonne pas à mon image, mais eux me façonnent à leur ressemblance.
Je suis dans les choses que mes prunelles ont capturées, je suis ce qu’elles regardent. Je crée la beauté des objets parce qu’ils se créent en moi. La beauté n’est pas dans les choses elles-mêmes, elle est dans les yeux qui la voient. Je crée par eux, je pousse le monde à être. De mes yeux qui contiennent des millions de gouttes d’amour, sortent les plantes et les bêtes, les magnifiques formes corporelles du monde dans lesquelles leur vie s’intègre. Je regarde et je suis regardé. Mes regards font éclore chaque chose et chaque chose me fait éclore par l’acuité de mes regards. Ils sont souples à suivre avec une vélocité merveilleuse les reflets les plus tenus qui jaillissent des objets.
Mes yeux mêlent les couleurs, brassent les contours, équilibrent la concordance des parties, provoquent l’unité des contrastes. Ils gravent les puissances analogiques et le feu du symbole au cœur de l’univers. Cette beauté surgit dans les coulées, d’images, mes yeux se réjouissent de cette joie d’avoir œuvré de la beauté au milieu des apparences et des reflets qui nouent et se dénouent autour de cette joie de la vision parfaite.
Reflets massifs des images sur les surfaces, je les résorbe et ils me résorbent. De toutes parts, ils giclent des objets les plus inconciliables, dont ils sont les projections. Moi aussi, je génère des images qui s’agencent et se composent avec des éléments étrangers à moi, et dont je suis cependant la substance première. Mon œil, précipité dans une course enivrée, rassemble les rapports entre les choses et les êtres, les engrange et les rejette à la fois, heureux de ces captives amicales qui le font subsister. Imprévues et soudaines parfois, le plus souvent tranquilles comme des oiseaux immobiles dans la cage des branches, elles détiennent toujours une vertu explosive.
***
Féerie créatrice qui infuse aux objets leur valeur réelle, leur valeur plastique, elle m’introduit dans la fête des formes, elle me projette dans la noblesse de l’univers. Les tons, les lignes, l’accord entre eux, la fusion de leurs contrastes, de leur visibilité et de leur ordonnance, c’est la substance de mes regards qui les mène à cet accomplissement ! C’est la beauté dans mes regards qui siège en eux et les transmute.
Mes regards portent dans leur lumière la lumière de la féerie. Par cela seul que je regarde avec une joyeuse convoitise les choses de la Terre, mes regards s’aiguisent et s’éclairent, et les choses deviennent translucides, je passe au travers d’elles comme au travers d’une eau. Par celà seul que ma vue promène ses feux autour de moi, je prends possession, en son entier, du royaume de la Terre et du ciel. Elle me fait sonder le fond foudroyant du monde, l’effroyable chaos de la grande nuit. Et c’est pourquoi mes yeux portent les reflets de cette vision au fond de leur rétine comme les taches incendiées que l’on garde dans les prunelles pour avoir trop longtemps fixe le soleil.
La vue est “il piu degno senso”, le sens le plus élevé en dignité, comme le dit de Vinci. Elle me permet d’avoir le monde au bout de mes regards et de mes doigts. Elle me donne cette instinctive terreur des ténèbres, parce qu’elle doit inlassablement virevolter dans le clair univers et pousser ma pensée dans le plein vent de la réalité.
Je ne suis pas parce que je pense. Je suis parce que le monde existe en-dehors de moi !
La vie existe sans moi. Le jour frappe le centre de mes rétines, et alors les monts, les torrents, les fourmis, les vallées, les oiseaux, viennent a moi, existent par eux-mêmes. Que je disparaisse, le monde existera toujours !
***
Images du monde qui répondent à l’appel de ma vue et meublent mon cerveau de souvenirs ! Mon champ visuel est circulaire, il est concave avec les perspectives et les vastes surfaces semées de formes qu’il embrasse. Chacun de mes coups d’œil éveille, suscite une image qui garde en elle la forme de ma rétine, et ainsi se trouve imprimée en elle la forme même de l’univers. Formes de mes yeux allongés et sphériques, et qui pivotent promptement dans leur orbite afin de viser dans toutes les directions ! Organes de la féerie qui savent fouiller les fissures de la lumière, le domaine de l’évidence oculaire, qui me tiennent en relation avec le monde et me renseignent sur le poids des choses !
Mais ce n’est pas seulement par mes yeux que je prends contact avec la vie et que je la ramène au point qu’elle me parait une œuvre de mes rétines, ployée, façonnée, soumise. Les organes de ma vue sont placés aussi dans mes sens. Ma chair est constellée d’yeux qui regardent par elle et qui la font béer d’ouvertures infinies sur la création. De là, cet énorme butinage de formes et de sensations que les essaims d’abeilles de mes regards ramènent constamment au rucher…
Mon œil est concentré sur les volumes et les figures de la vie, l’intensité de sa pesée sur les choses, dans son ivresse, peut m’abolir au sein de la création, mais non point en moi-même. Il peut me désincarner en m’incarnant dans les êtres, la Terre et le ciel. Je me mélange à la matière. C’est là mon effort créateur.
II n’y a pas en moi de méditation centrale que celle qui se médite dans les autres. Ma contemplation est pointée à la cime de mon regard, elle est active. Ce sont mes yeux qui méditent. Ma vue contemplative est rétinienne. Ma vision crée, mon œil crée : la création sort de moi, et s’ordonne comme une révélation.
Je vis du dedans au dehors. Je me développe dans les formes de la vie qui sont les limites du monde. Je travaille à la surface. Je n’aperçois, je ne palpe que des corps, que des volumes : le fond se glisse entre l’espace de mes veines, il m’échappe, et je n’existe qu’à l’extérieur de mes ouvrages.
***
Beauté des signes, dignité des surfaces, elles sont moi et je suis elles. Et par elles, je rejoins le grand dessein, j’imite ce qui fait les choses. Mes yeux, mes mains, mes narines, mes oreilles, ma langue, savent comment se saisir du derme de la vie, l’éprouver, le reconnaître, et s’en réjouir. Mais quelles épaisseurs de ténèbres ne faudrait-il pas traverser jusqu’à cette dernière teneur de moi-même que serait la contemplation du vide — avec quel sens vague et sans puissance de coordination appréhender le visage du fantôme qui se défait dans les brouillards et qui m’exténuerait si je persistais à vouloir le débusquer !
Voir, toucher, humer, ouïr, goûter, et les autres appétences qui sont miennes, appellent les pouvoirs de la concentration active sur la matière, cette matière dont la substance est amour dans ses assises et ses cadences charnelles.
Puissance des surfaces, gravité des apparences, enveloppes éblouissantes d’ombre et de lumière des bêtes, des végétaux et des hommes, qui révèlent les corps impénétrables, qui projettent leur nature intime ! Les formes ont une mémoire. Sous la fugacité des reflets qui les parcourent, repose la présence permanente des choses qui sans cesse oscille en elles. À la pique du jour, je vois des taches roses qui glissent sur les dentelures des crêtes, et s’ordonnent, et vont tout à l’heure créer le matin. Ce n’est pas seulement moi qui vois. Voir ? II n’y a pas seulement mes yeux qui recueillent cette vision. La pique du jour ? Mais peu m’importe que ce soit l’aube ou que ce soit encore la nuit. Des formes, des irisations ? Ce que je vois est plus que de la couleur et plus que des lignes. Je décèle autre chose qui prolonge cette naissance du Soleil, qui se développe, et suscite en mon corps je ne sais quelles lumières, je ne sais quel appel de vision dans le passé et dans le présent de ma chair. Les images ? Cette transfiguration qui arrive dans le cercle de mon regard par leur frémissante présence, est-elle due seulement à ces crêtes qui boivent à la clarté de L’aube ? II y a autre chose, je le perçois bien, quelque autre alchimie qui transforme le monde et qui se nomme féerie. Et comme je suis celui qui confesse mes yeux et pique leurs images du bout de ma plume, je projette sur le papier avec les symboles et les jeux de la parole écrite, ce matin qui se rit au haut des crêtes.
***
Connaissance de mon œil, cette sentinelle qui scrute et parle, veille et frappe, qui sert de langue et de main aussi. J’ordonne, je conjugue les mondes épars, les poussières d’astres, les sables.
Pourquoi l’immensité de mes clins d’œil, ces fous du cœur ! J’éclate de millions d’yeux qui tournent comme une roue de miroirs. Des yeux braqués au dehors, toujours au large et qui propulsent la force de la féerie. Comme mes mains, ils sont des créateurs.
Car je deviens ce que je vois dans la nuit comme dans le jour.
Les choses de la Terre m’atteignent par mon corps, à travers mes yeux, et sans mes yeux aussi. Même si je devenais aveugle, mon corps verrait encore par des regards d’aigle. Ma peau tendue sur ma chair perçoit le monde qui lui arrive par bonds et par engouffrements. Ma peau est accordée aux univers par des radicelles frémissantes qui voient.
Article suivant — Pureté brutale des masses minérales